
L’appel
de l’art
Il m’aura fallu longtemps, je l’avoue, pour découvrir que certaines œuvres, je les admirais, mais ne les aimais pas vraiment, et qu’avec l’âge mon admiration pour elles se continuait sans que s’accrût mon affection. Ce n’était pas condamner ces œuvres. S’il y avait jugement, il était tout à leur gloire. En revanche, je me jugeais, m’approchais davantage de moi-même par ce départ entre l’admiration et – quel mot employer ? « aimable » prêterait aux faux sens, disons « aimé », en risquant l’impudeur, voire l’imprudence – l’aimé, donc.
Entre l’admirable et l’aimé, ne serait-elle point ici la critique que Baudelaire fondait sur la différence ? Lorsque j’entrais dans l’adolescence, je vendais en cachette les livres de la bibliothèque de mon père, inventant mille malices pour emplir les vides et masquer les absences. Mes livres scolaires, bien sûr, avaient été les premiers sacrifiés, car l’entreprise était avec eux plus facile, je pouvais argumenter de la perte ou d’un larcin. Pour les autres, je devais ruser.
Il m’aura fallu longtemps, je l’avoue, pour découvrir que certaines œuvres, je les admirais, mais ne les aimais pas vraiment, et qu’avec l’âge mon admiration pour elles se continuait sans que s’accrût mon affection. Ce n’était pas condamner ces œuvres.
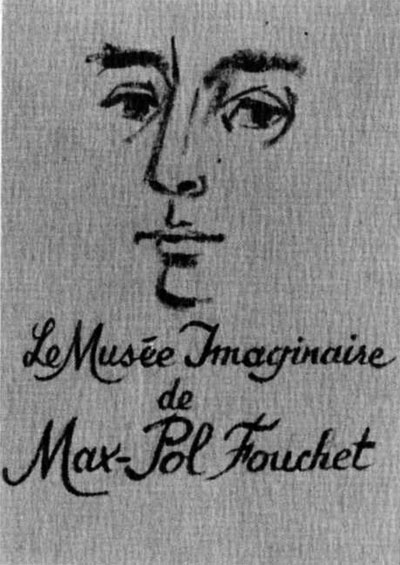
S’il y avait jugement, il était tout à leur gloire. En revanche, je me jugeais, m’approchais davantage de moi-même par ce départ entre l’admiration et – quel mot employer ? « aimable » prêterait aux faux sens, disons « aimé », en risquant l’impudeur, voire l’imprudence – l’aimé, donc.
Entre l’admirable et l’aimé, ne serait-elle point ici la critique Baudelaire fondait sur la différence ?
Lorsque j’entrais dans l’adolescence, je vendais en cachette les livres de la bibliothèque de mon père, inventant mille malices pour emplir les vides et masquer les absences.
Mes livres scolaires, bien sûr, avaient été les premiers sacrifiés,
car l’entreprise était avec eux plus facile, je pouvais argumenter de la perte ou d’un larcin. Pour les autres, je devais ruser.
Comme mon père recouvrait avec soin les ouvrages, il m’était loisible de garder les couvertures, de les emplir de papiers divers afin de garder l’épaisseur, puis de filer chez le bouquiniste. Je courais, certes, des risques, mais une si forte passion m’habitait que ces risques et la crainte du châtiment me paraissent le prix de cette passion même, de son amer apaisement, amer parce que je le savais momentané. Je vendais les livres familiaux pour acheter des tablettes de chocolat.
Avais-je pour le chocolat une gourmandise immodérée ?
Non pas (…) toutes les vignettes de l’industrie chocolatière m’étaient belles. Je les aimais plus que les livres que j’admirais.
Vaincre la force de l’indifférence
La souffrance du retour
Le Musée imaginaire - suite

